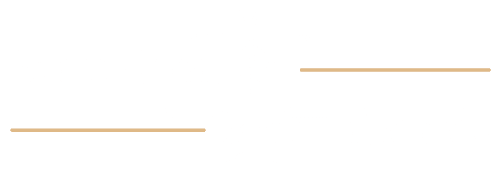L’affaire Julie, violée par 22 pompiers

En 2010, une jeune fille a accusé vingt pompiers de l’avoir violée, de ses 13 ans à ses 15 ans. Après dix ans d’une interminable instruction, les juges d’instruction ont décidé de requalifier ce qu’elle a subi en « atteinte sexuelle ». Avec sa famille, elle a saisi la Cour de Cassation pour que ses agresseurs soient bien jugés pour viol.
Que ses agresseurs soient jugés pour “viol”, et non pour “atteinte sexuelle”. C’est ce que demande Julie à la Cour de Cassation. En 2010, la jeune fille, alors âgée de 15 ans, porte plainte avec sa famille contre vingt pompiers : elle les accuse de l’avoir violée plusieurs fois entre 2008 et 2010.
Tout commence en avril 2008. Julie a alors treize ans, habite en région parisienne et est élève en classe de quatrième. Alors qu’elle fait une crise de spasmophilie au collège, les pompiers la prennent en charge.
En chemin pour l’hôpital, l’un d’eux monte à l’arrière du camion avec elle. Il en profite pour prendre son numéro de téléphone, et le communiquera par la suite à certains de ses collègues. À partir de là commence une période où elle multiplie les relations sexuelles avec les pompiers. Une de ses avocates, Lorraine Questiaux, la décrit comme ayant été prise dans une campagne de cyberharcèlement : “Elle allait de plus en plus mal parce que d’autres pompiers lui envoyaient des images à caractère sexuel, ou lui faisaient des avances, ce qui est très perturbant pour une jeune fille de cet âge-là”.
Au début, Julie ne se confie pas sur le harcèlement qu’elle subit. Elle affirme même vouloir devenir pompier à son tour. Sa mère, qui ne se doute pas de la situation dans laquelle se trouve sa fille, décide d’organiser une rencontre, dans leur appartement, avec le pompier qui avait pris son numéro quelques mois plus tôt.
Un long parcours judiciaire
Julie finira par affirmer que le pompier profite de l’absence de sa mère pour la violer. Ce premier rapport est le début d’une longue série de relations sexuelles avec vingt-deux pompiers différents, qui ont eu accès à son numéro. Au total, les pompiers interviennent plus de 130 fois entre 2008 et 2010 pour secourir Julie, qui enchaîne les crises de tétanie. Pour les pompiers, ces interventions sont l’occasion de maintenir le contact avec la jeune fille. Les rapports sexuels continuent, que ce soit dans un jardin public, dans leur appartement ou dans celui de Julie, ou encore dans l’hôpital pédopsychiatrique dans lequel elle est internée pour un temps.
En 2010, Julie finit par arrêter le traitement médical qu’elle suit et change de médecin. C’est à ce moment-là qu’elle décide de se confier à sa mère, Corinne Leriche. Au mois d’août, celle-ci tente de contacter le chef de l’une des casernes concernées. Il faudra ensuite six mois pour qu’une enquête interne soit ouverte. Alors que de nombreux pompiers avouent avoir eu des relations sexuelles avec Julie, la police se saisit de l’enquête.
S’ensuit un long parcours judiciaire. En février 2011, trois pompiers sont mis en examen pour “viol en réunion sur mineur de moins de 15 ans”. Sur les dix-neuf autres restants, deux sont décédés en intervention. Les dix-sept autres ne sont pas poursuivis : ils affirment ne pas avoir été au courant de l’âge de Julie à l’époque des faits et ne jamais l’avoir forcée.
Des preuves manquantes
Comme dans beaucoup d’autres affaires de viol, c’est bien le point central: l’instruction a surtout du mal à établir s’il y a eu consentement ou non entre la plaignante et les accusés. Dans le cas de Julie, l’enquête est également ralentie par certaines contradictions dans les déclarations de la jeune fille. Elle affirme notamment avoir été séquestrée, avant de retirer ces propos. Les experts psychiatriques qui interviennent dans le dossier la décrivent comme immature, influençable, et ayant des comportements “auto-punitifs” et une “propension à la fabulation”. Julie elle-même dira qu’elle agit ainsi par “besoin de se faire mal”.
C’est sur cette base que la défense construit son argumentation. Les pompiers affirment que Julie les contactait elle-même avant chaque rapport sexuel par les réseaux sociaux, ce que la jeune fille dément. Contactés par “Verdict”, les avocats des pompiers n’ont pas souhaité s’exprimer.
Pour Véronique Le Goaziou, sociologue spécialiste des violences et de la délinquance et auteure de “Viol, que fait la justice ?,” c’est ce manque de preuves qui tend à obstruer le jugement dans les affaires d’abus sexuels. “Les violences dans l’entourage de la victime, de manière générale, sont assez difficile à prouver, sauf si on a à faire à des violences physiques dont on peut trouver des traces. Mais les emprises, les violences morales, les menaces, les régimes de terreur qui peuvent être mis en place par les auteurs sont extrêmement difficiles à prouver. Or, la justice ne peut pas fonctionner sans preuve : elle a besoin d’éléments à partir desquels déterminer que les faits ont bien eu lieu”, détaille la sociologue.
Cependant, c’est bien sur ce phénomène d’emprise qu’insistent les avocates de Julie. Selon Lorraine Questiaux, en plus d’avoir profité du fait qu’elle était sous traitement médicamenteux, les pompiers ont exercé une pression morale sur la jeune fille : “On peut très bien comprendre pourquoi elle s’est tue. Quand on subit des violences comme celles-là, on a peur de ne pas être crue. Il faudrait aussi évoquer l’ensemble des agissements et stratagèmes des agresseurs, qui visent à la réduire au silence, que ce soit par des menaces ou du chantage. C’est un ensemble de comportements qui lui laisse croire qu’elle ne sera pas crue, et que ce qui lui arrive est normal”.
En novembre 2020, la Cour d’appel de Versailles estime que Julie a été victime d’un délit, non pas d’un crime. Les pompiers devraient donc être jugés au tribunal correctionnel pour “atteinte sexuelle”, au lieu de comparaître devant la Cour d’Assises pour “viol”.
Un rare aboutissement des plaintes pour viol
C’est tout l’enjeu du recours en Cassation qu’ont entrepris Julie, aujourd’hui âgée de 25 ans, et ses avocates : faire en sorte que les faits soient de nouveau qualifiés de “viol”. L’audience a eu lieu le 10 février, mais la Cour de Cassation ne devrait rendre son verdict que le 17 mars prochain. Si le recours est validé, les accusés seront jugés en Cour d’Assises, et s’exposeront donc à des peines plus lourdes qu’en correctionnelle.
Selon Véronique Le Gaoziou, ce changement de qualification, qu’on appelle “correctionnalisation”, est un “processus normal” dans le système judiciaire. “Les différents acteurs de la chaîne pénale peuvent à tout moment requalifier une affaire. C’est-à-dire qu’ils estiment, au vu des éléments dont ils disposent, que l’affaire qui avait été qualifiée comme un viol n’en est pas un”, précise la sociologue.
Pour autant, la sociologue explique que le processus le plus courant, concernant le traitement des affaires de viol, est le classement des plaintes. Dans son ouvrage, elle explique que 70 % des plaintes pour viol sont classées sans suite : “Le motif de classement le plus connu, c’est la prescription. Mais il y en existe une trentaine d’autres. En matière de viol, le motif le plus utilisé est ce qu’on appelle l’“infraction insuffisamment caractérisée”. Cela veut dire que le parquet pense ne pas avoir assez d’éléments pour commencer à enquêter”.
Une affaire emblématique
Le cas de Julie a connu un certain retentissement dans la société civile. Le dimanche 7 février, Corinne Leriche, les avocates de sa fille et de nombreuses associations féministes ont appelé au rassemblement devant la fontaine Saint-Michel à Paris, afin de faire pression sur la Cour de Cassation. Au total, environ 300 personnes ont répondu à l’appel de la mère de Julie.
Une mobilisation dont Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, espère qu’elle portera ses fruits lors des débats parlementaires : “À chaque fois que l’on veut faire progresser les lois, ça se fait par la mobilisation, sur le terrain. Ensuite, des lois progressives viennent conforter ces acquis. Ça a été le cas pour l’interruption volontaire de grossesse : s’il y a eu la loi Veil, c’est qu’il y a eu des mobilisations antérieures”.
La sénatrice affirme vouloir accompagner cette mobilisation des associations pour les droits des femmes au sein de l’hémicycle. Pour elle, cela fait longtemps que les femmes prennent la parole, mais elles n’ont pas toujours eu conscience de l’existence d’un système inégalitaire plus global.
Malgré tout, Laurence Cohen a bon espoir. Pour elle, une affaire comme celle de Julie et la mobilisation qu’elle suscite peut avoir un impact réel sur le droit et la manière de rendre la justice.
Aujourd’hui il y a quand même des changements des mentalités. La mobilisation autour de l’affaire Julie permet de mettre en accusation les verdicts tels qu’ils ont été rendus. Il y a une vraie évolution de la prise de conscience chez les femmes comme chez les hommes, c’est très positif.
Laurence Cohen